Il fut un temps où la coopération industrielle entre les deux pays a fêté ses beaux jours. Aujourd’hui ce sont les gouvernements qui la souhaitent toujours mais la réalité industrielle est tout à fait différente.
Un rapport de Jean-Louis Thiérot (Assemblée Nationale) et Jean-Charles Larsonneur (Sénat) est clair : « aujourd’hui on est loin d’une coopération réussie avec des produits comme la Transall-160, l’Alphajet, ou le missile antichar Milan. Le principe du « meilleur athlète » s’efface généralement devant le concept de « retour géographique ». Le député et le sénateur reprochent à l’Allemagne d’être « un cheval de Troie pour les intérêts d’outre Atlantique ». Et il continue que Berlin suivrait « une stratégie d’influence non coopérative en Europe ». Leur conclusion : « [. . .] Les récents échecs de la coopération avec l’Allemagne démontrent que la France a tout intérêt à renforcer ses partenariats avec d’autres pays européens ». Ils évoquent la Pologne et la Suède.

Le rapport élucide plusieurs problèmes. Il y a d’un côté le souhait politique de coopération. Il y a de l’autre la coopération économique des entreprises qui se trouve faussée par la politique. Il y a une coopération d’entreprises basée sur les exigences du marché. Et il y a des exigences sur la situation économique et politique causée par la guerre en Ukraine. On achète là où on trouve en temps voulu les produits dont on a besoin. Si par exemple Dassault n’augmente la cadence de la production du Rafale qu’après trois ans de guerre, c’est trop tard et insuffisant. Le besoin dicte les décisions d’achat.
Lorsque les députés de la commission budgétaire du Bundestag avaient libéré quatre milliards d’Euros pour l’avion de chasse de coopération franco-allemande, ils avaient mauvaise conscience. Il y en avait même qui étaient d’avis « qu’on s’était fait avoir par un mauvais contrat avec la France ». La raison : Français et Allemands n’arrivaient pas à se mettre d’accord sur le partage des travaux. Dassault était d’avis que le savoir-faire était de son côté et qu’il ne fallait pas partager les brevets avec les Allemands. La confiance nécessaire n’existait pas. Les tensions étaient telles que le PDG de Dassault avait menacé de quitter la coopération et de construire seul le futur avion de combat. La chancelière allemande de l’époque, Angela Merkel, avait essayé de calmer la situation en invitant l’Espagne à se joindre au couple franco-allemand en crise. Les idées de fabriquer un avion militaire et un char en commun date de 2017. Sept ans plus tard on n’a toujours pas de résultat en forme de produit.
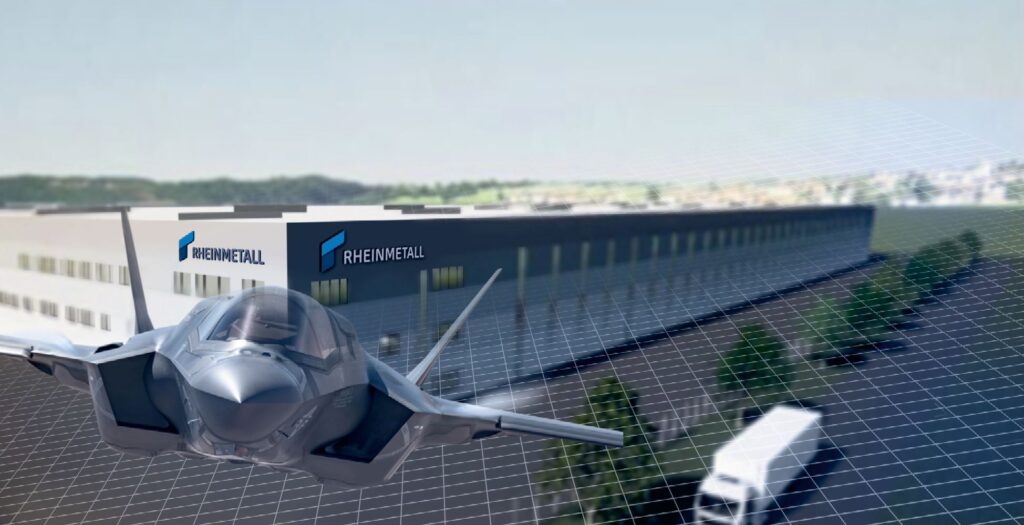
Même la décision des deux gouvernements de laisser le projet de l’avion futur à la France et de charger l’Allemagne du futur char n’a pas pu restituer l’ancienne base de coopération. Français et Allemands se disputent sur la question du calibre du canon : 140 mm (français) ou 130 mm (allemand). Le géant de production d’armes allemand, Rheinmetall, s’est retiré sur une position de sous-traitant et a conclu un traité de coopération avec son homologue italien pour développer un char commun, qui peut déjà se baser sur une commande de 23 milliards d’Euros de l’armée italienne. Pourtant les deux gouvernements à Berlin et Paris soutiennent toujours le projet franco-allemand de Krauss Maffei Wegmann/Nexter qui reste sans résultat. Il paraîtrait que le désaccord franco-allemand détruirait un futur standard technologique de l’OTAN.
Si au bout de trois ans de guerre les industriels franco-allemands se permettent de se disputer sur le diamètre du canon, il est normal qu’une coopération privée allemande/italienne se crée, qui en plus proposera son produit plus tôt sur le marché. Si on augmente en France la cadence de production du canon « César » – la grosse Bertha des temps modernes – trois an après le début de l’invasion russe en Ukraine, il ne faut pas s’étonner que les Etats regardent ailleurs. Les Suisses et les Sud-Coréens produisent chars et avions ainsi que les Suédois. Le modèle Gripen suédois est considéré comme un concurrent sérieux pour les F35 et les Rafales. Les Allemands vont pourtant rester avec les F35 qui peuvent transporter les têtes nucléaires américaines, et les hélicoptères Chinook, qui sont livrables. Les Polonais achètent en Corée du Sud. Le député et le sénateur ont peut-être raison quand ils pensent que la grande période de coopération franco-allemande est révolue.

L’espoir qu’une grande partie de la manne allemande de 500 milliards tombe dans des entreprises françaises pourrait lui aussi être un rêve. En Allemagne la 10ème division de chars de 20.000 soldats attend d’urgence du nouveau matériel. Sa tâche sera la sécurisation de la Lituanie. Une Brigade de la division s’y trouve déjà près de la frontière biélorusse. Les Allemands y bâtissent une caserne avec écoles et habitations sur un terrain de 5.000 hectares. Un exemple qui montre qu’à la fin politiquement ce sera peut-être « l’amitié » avec la France, mais en réalité ce sera le délai de livraison qui comptera.
Fin de la série
Les articles sont parus dans la rubrique « politique » à ces dates :
Le coup de tonnerre 14/03/2025
Le parapluie nucléaire 18/03/2025
La dissuasion nucléaire 19/03/2025
Les difficultés s’accumulent 27/03/2025




